Cyclone
Un cyclone tropical est une perturbation atmosphérique tourbillonnaire, accompagnée de vents puissants et de fortes pluies, qui se forme sur les océans chauds de la zone intertropicale.
Cyclone
Un cyclone tropical est une perturbation atmosphérique tourbillonnaire, accompagnée de vents puissants et de fortes pluies, qui se forme sur les océans chauds de la zone intertropicale.
SAVOIR
Les cyclones se développent au-dessus des océans intertropicaux lorsque la température des eaux atteint environ 26°C sur 60 mètres de profondeur.
La vapeur d’eau s’élève vers les couches froides de l’atmosphère, formant des nuages épais et humides.
Sous l’effet de la force de Coriolis, ces masses d’air tournent et se déplacent dans le sens antihoraire dans l’hémisphère nord.
La vitesse de déplacement d’un Cyclone varie entre 20 et 40 km/h, rarement au-delà de 25 km/h. Les vents au centre peuvent atteindre 300 km/h, exerçant une pression de 450 kg par mètre carré sur des murs verticaux. La vitesse des rafales et la résistance des structures, ainsi que la topographie et l’agencement urbain, influencent les effets destructeurs du vent (effet Venturi).
Qu’est-ce qu’un cyclone ?
Un cyclone tropical est une perturbation tourbillonnaire constituée par des formations nuageuses importantes et épaisses d’assez grande échelle liée à une zone de basses pressions atmosphériques en surface. Ils s’étendent sur 500 à 1 000 km et leur centre, appelé œil du cyclone, est bien visible sur les images satellitaires. D’un diamètre généralement de 30 à 60 km (parfois jusqu’à 150 km), cet œil est une zone d’accalmie (pas de pluie, vent faible) (MétéoFrance, consulté en 2024).

La vie d'un cyclone dans l'Atlantique Nord
Les phénomènes cycloniques de l’hémisphère Nord se forment de juin à novembre avec une période particulièrement intense entre juillet et octobre. Dans l’océan Atlantique la majeure partie naît entre le continent Africain et les Antilles. Ces phénomènes dits « cap-verdiens » se forment à partir de perturbations tropicales en provenance d’Afrique, développées à proximité des îles du Cap-Vert.
Le cycle d’évolution du cyclone comporte 4 stades : la phase de formation, la phase de développement, la phase de maturité et la phase de déclin. Au cours des phases de formation et de développement, le système tropical se déplace à des vitesses souvent différentes et en général infléchit sa trajectoire à droite dans l’Hémisphère Nord. En moyenne, la durée de vie d’un cyclone est de 9 jours, mais elle peut atteindre voire dépasser 20 jours. Certains peuvent atteindre leur stade de maturité au bout de plusieurs jours, d’autres en moins de 48 heures.Tout au long de son parcours, il peut lui arrive de s’arrêter, de rebrousser chemin ou même d’effectuer des boucles, rendant très délicate la prévision de sa trajectoire.
Formation
Le cyclone se développe le plus souvent au sein d’une masse nuageuse évoluant au-dessus de la mer et présentant une forte activité convective et située entre les parallèles 5° et 15°.
Développement
Au cours de cette phase, les plages de nuages s’organisent suivant une configuration particulière et les vents se renforcent, atteignant ou dépassant la force du coup de vent (34 nœuds ou 62 km/h).
Maturité
Le cyclone atteint sa puissance destructrice maximale dès lors les masses nuageuses sont organisées en une masse compacte centrale au centre de laquelle apparaît le plus souvent un œil (entre 30 et 50 km de diamètre).
Déclin
Elle intervient lorsque le cyclone ne rencontre plus les conditions essentielles à son existence, à savoir de l’air chaud et humide, une température de la mer de 27°C ou une circulation en altitude propice. L’intensité du phénomène décroît alors rapidement.
Classification de l'intensité des cyclones tropicaux
L’échelle de Saffir-Simpson classe l’intensité des cyclones tropicaux en cinq catégories selon la vitesse des vents soutenus sur une minute, mesurée à 10 mètres de hauteur. Utilisée dans l’Atlantique et le Pacifique Nord-Est, elle indique la force maximale atteinte par un ouragan, comme Irma en 2017 (catégorie 5). D’autres bassins cycloniques emploient des classifications similaires basées sur une moyenne des vents sur dix minutes, avec des catégories et des noms spécifiques définis par l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM).
4 phénomènes générateurs de dommages
L’atterrissage d’un cyclone sur un territoire provoque des effets en cascades et des effets combinés qui amplifient les conséquences des aléas cycloniques. Ces phénomènes induits par le passage d’un cyclone sont générateurs de nombreux dommages liés aux quatre phénomène ci-dessous :
Vents et rafales
Destruction des toitures, réseaux électriques, habitations précaires, cultures agricoles, végétation déracinée et défoliation. Les dommages sont étendus et plus intenses au niveau des crêtes et dans certains quartiers selon l’urbanisme (survitesse par effet venturi).
Pluies
En fonction du bassin versant et des pentes, les pluies font gonfler les débits de cours d’eau, qui en crue peuvent sortir de leur lit et inonder les espaces alentours. L’écoulement peut évoluer en lave torrentiel (charriant blocs rocheux et sédiments), et peut conduire à des inondations par ruissellement notamment dans les zones urbaines mal drainées, établies sur d’anciens étangs et/ou sous équipées en système d’évacuation des eaux de pluie. Les pluies sont aussi susceptibles de déclencher des mouvements de terrains et des coulées boueuses.
Etats de la mer
Lorsqu’un cyclone arrive sur une terre, le niveau de la mer s‘élève de plusieurs mètres à cause des basses pressions, de la topographie côtière, de l’angle suivant lequel le cyclone touche la terre, de la vitesse de déplacement du cyclone et de la force du vent. Selon la topographie, les points bas du littoral seront susceptibles d’être inondés.
Déferlement des vagues
Le déferlement des vagues provoque une action mécanique et génèrent des projections de matériaux qui amplifient les dommages sur les infrastructures côtières. Les phénomènes de résonance en accentuent les effets. Enfin, les ondes infra gravitaires sont un phénomène dominant qui amplifie les extrêmes comme le niveau de la mer et les hauteurs de vagues, et qui accroit les dommages par exemple dans les bassins portuaires, les fronts urbanisés, les dunes.
Individuels ou combinés, ces phénomènes naturels sont capables de détruire les réseaux électriques, de gaz, d’eau et d’assainissement, les réseaux de télécommunication ainsi que les accès routiers.
Principaux sites exposés aux dommages sur l’île de Saint-Barthélemy

Les crêtes
Elles sont plus exposées et vulnérables aux vents à cause des effets venturis (des rafales supérieures à 244 km/h à Saint-Barthélemy).
Les points les plus bas
Les points les plus bas de l’île comme St Jean, Saline, Gustavia, Public, Grand Fond, sont très exposés aux inondations marines.
Le port de Gustavia
Il est d’autant plus exposé lorsque les houles entrent en résonnance dans le bassin.
Les systèmes côtiers
Les systèmes côtiers les plus dégradés sont les plus sensibles aux effets des houles cycloniques. Leur récupération est d’autant plus difficile et longue comme à St Jean, Lorient, Flamands.
ANTICIPER
S’informer sur le risque cyclonique
Suite au passage du l’ouragan IRMA sur l’île de Saint-Barthélemy les 5 et 6 septembre 2017, la mission du Cerema a pu établir du 20 au 24 février 2018, des relevés ponctuels sur les côtes basses (Plus Hautes Eaux de mer, laisses de haute mer, jets de rive, pieds de dune et de falaise dunaire).
Le Cerema a établi à dire d’Experts et à l’aide de ses relevés de terrain, un Modèle Numérique de la Surface en Eau (MNSE) du niveau maximal de la submersion marine. Ce MNSE a ensuite été croisé avec le Modèle Numérique de terrain (MNT) le plus récent (MNT au pas de 5 m fourni par l’IGN de 2010). L’organisme précise que : » les hauteurs de submersions marines comptées à partir du terrain naturel, ont peut-être été localement minimisées ou maximisées à cause des limites techniques de production de cette carte.
Habitation en bord de mer après le passage du cyclone Irma (JDB, 2017)
FOCUS sur :

Le Cerema, établissement public relevant du ministère du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation, du ministère de la Transition écologique, de l’Énergie, du Climat et de la Prévention des risques et du ministère du Logement et de la Rénovation urbaine, accompagne l’État et les collectivités territoriales pour l’élaboration, le déploiement et l’évaluation de politiques publiques d’aménagement et de transport.
Cartographie des hauteurs de submersions marines établie par le Cerema en 2017
Les phases de vigilance cyclonique
Il est possible de s’informer sur la saison cyclonique et les gestes à connaître et de se renseigner auprès des pouvoirs publics locaux, pour connaître les différents niveaux de vigilances afin de se préparer et anticiper les évènements cycloniques.

Plaquette cyclonique nouvelle version
Le service Sécurité Civile de la Collectivité a exprimé le souhait de moderniser la plaquette d’information sur les consignes cycloniques. Cette nouvelle version s’appuie sur le contenu de l’ancienne plaquette, enrichi par des sources complémentaires telles que le numéro spécial cyclone du Journal de Saint-Barth et les recommandations disponibles sur le site de la Préfecture. La face recto présente de manière claire les cinq phases de vigilance cyclonique, tandis que le verso rassemble des informations pratiques sur le sac d’urgence 72h, les modalités d’alerte et les abris sûrs.
Recto
Verso
La Collectivité territoriale de Saint-Barthélemy met à disposition les brochures d’information sur la saison cyclonique sur le site internet de la Collectivité. Vous pouvez également vous inscrire et recevoir les messages d’alerte et d’information concernant la gestion des risques majeurs.
FAIRE FACE
Avoir les bons geste : avant, pendant, après
AVANT
Je me prépare
• Je suis les bulletins météo et les alertes des autorités locales
• Je prépare un plan d’évacuation : repérer les itinéraires sûrs et les lieux de refuge en cas d’urgence, informer les membres de la famille des consignes
• Je stocke du matériel d’urgence, et je garde à disposition des provisions et mon kit 72H
• Je protège mon habitation : renforcer les ouvertures avec des volets ou contreplaqué, élaguer les arbres pour éviter les chutes de branches, vérifier les drains et les gouttières
• Je range ou sécurise les objets extérieurs et je mets les animaux à l’abri si j’en possède
PENDANT
J'ai les bons réflexes
• Je suis les consignes des autorités et je me tiens informé·e de l’évolution de la situation
• Je me réfugie dans une pièce intérieure éloigné·e des ouvertures
• Je débranche les appareils électroniques, électriques et le gaz
• Je me protège contre les débris volants en me couvrant avec des matelas ou des couvertures si nécessaire
• Je m’abstiens de sortir, même pendant l’accalmie provoquée par le passage de l’œil du cyclone, sauf si cela est absolument nécessaire
APRES
Je reste vigilant·e
• Je m’informe en écoutant la radio et j’évite de téléphoner sauf en cas d’extrême urgence
• J’attends l’autorisation des autorités de pouvoir circuler
• J’aide mes voisin·e·s, je porte assistance aux personnes en difficulté
• Je fais un constat des dégâts : prendre des photos et des vidéos pour les assurances
• Je fais vérifier les installations électriques et de gaz par un professionnel
• J’évacue les déchets et débris avec précaution, en utilisant des gants
Constituer son sac d’urgence
D’après la Croix Rouge, il est conseillé d’avoir un sac d’urgence par personne. Sa composition doit couvrir les cinq besoins vitaux d’une personne en cas de crise, à savoir :
o s’hydrater : eau potable en quantité, prévoir 2L par personne au minimum
o se nourrir : nourriture non périssable et ne nécessitant pas de cuisson
o se soigner : trousse de premiers secours ; alcool, pansements, compresses, médicaments, traitement, trousse de toilette
o se protéger : outils de base type couteau multifonction, double des clés, photocopies des documents essentiels dans une pochette étanche, argent liquide, couverture de survie
o se signaler : téléphone portable avec chargeur solaire, radio à piles (avec piles de rechange), lampe de poche, sifflet
FOCUS sur :
La Croix-Rouge est une organisation humanitaire internationale fondée en 1863, engagée dans l’aide aux victimes de conflits, catastrophes et crises sanitaires.
UNE PERSONNE = UN SAC-A-DOS

ECHANGER
Que s’est-il passé sur l’île de Saint-Barthélemy ?
D’après les archives du Centre des Ouragans (NHC) en Floride, l’activité cyclonique historique (nombre de tempêtes tropicales et ouragans) est surtout concentrée au voisinage de la côte Est des Etats-Unis, dans l’extrême Nord-Ouest de la Mer des Caraïbes et dans le Golfe du Mexique. La carte ci-contre fait état de la situation de la Guadeloupe et des îles du Nord dans leur contexte cyclonique historique sur la période 1956-2018.
Trois cyclones dévastateurs à Saint-Barthélemy
Les cyclones marquants à Saint-Barthélemy
Cyclone Luis
1995
Catégorie 4 avec des vents enregistrés à 225 km/h

Le cyclone Luis a été l’un des plus destructeurs de la saison des ouragans de l’Atlantique cette année-là. Formé le 27 août, il a atteint des vents soutenus de 225 km/h, causant des ravages majeurs dans les îles de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Anguilla, Antigua et Barbuda. Avec environ 17 morts et des dommages estimés à plusieurs milliards de dollars, Luis a laissé des milliers de personnes sans abri et a gravement endommagé les infrastructures locales, soulignant la nécessité d’améliorer les systèmes d’alerte et de préparation aux ouragans dans les Caraïbes.
Cyclone Lenny
1999
Catégorie 4 avec des vents enregistrés à 250 km/h

Ce cyclone a eu une trajectoire inhabituelle d’ouest en est en Mer des Caraïbes, formant une houle qui a surpris et déferlé violemment sur les rivages habituellement protégés. D’autre part, Lenny a eu une vitesse de déplacement très lente, quasi stationnaire sur l’île de Saint-Barthélemy du 17 au 19 novembre, l’œil passant à plusieurs reprises sur l’île. Les dégâts ont été considérables notamment sur les fronts de mer qui, à l’époque, étaient bien moins urbanisés qu’aujourd’hui.
Enfin, anachronique, Lenny atterrit sur l’île de Saint-Barthélemy à la fin de la saison cyclonique surprenant alors la population.
Cyclone Irma
2017
Premier cyclone de catégorie 5 à avoir touché l’île de Saint-Barthélemy depuis le début des enregistrements climatiques.

Irma s’est initialement formée le 30 août 2017 au large des îles du Cap-Vert à partir d’une onde tropicale. Au cours des 30 heures suivantes, Irma s’est intensifiée pour devenir un ouragan de catégorie 3, avec des vents soufflant à plus de 185km/h.
Le 4 septembre, une alerte cyclonique est émise par le NHC de la NOAA à destination des îles du nord. Alors alimenté par les eaux chaudes au-dessus desquelles il évolue, l’ouragan s’intensifie rapidement entre le 4 et 5 septembre à l’approche des Antilles françaises.
Les vents ont été soutenus dépassant les 297 km/h pendant 37h. Bien que pour les îles du nord, son déplacement ait été relativement rapide, Irma aura tout de même entraîné le décès de 136 personnes dont 11 à Saint-Martin ainsi que d’importants dommages aux infrastructures sur les îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin avec près de 95% du bâti endommagé pour cette dernière.
Retour sur la saison cyclonique 2017
FOCUS sur :
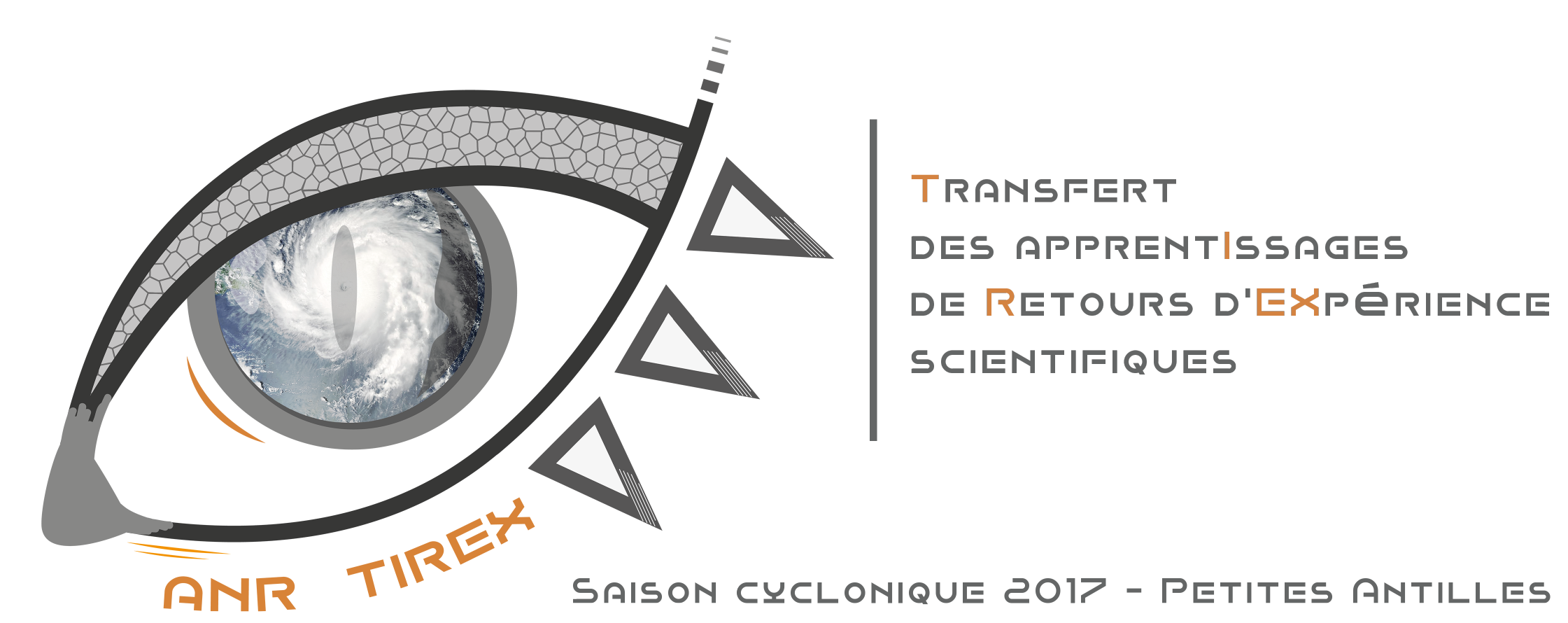
Le projet TIREX part d’un constat, celui de l’absence de transfert de connaissances acquises lors d’un précédent projet de cette nature suite au cyclone Lenny (1999) sur les Petites Antilles du Nord (programme EPR du MEDD, Sarant et al., 2003 ; De Vanssay et al. 2004). Il s’inscrit dans une continuité de recherche en renforçant le suivi de la reconstruction territoriale, en favorisant l’analyse comparative entre territoires du Nord des Antilles, en formalisant des méthodes de RETEX scientifique continu.
Sur les îles du nord des Petites Antilles, les références cycloniques répertoriées jusqu’alors restaient des événements de classe 4 (Luis 1995 à Saint-Martin). En septembre 2017, le cyclone IRMA, aggravé par deux autres cyclones, a mis dans le champ du possible une catastrophe superlative, obligeant à réfléchir à la façon de reconstruire plus résilient plutôt que reconstruire le plus rapidement possible avec le spectre d’autres évènements à venir.
Ces trois événements cycloniques successifs représentent à la fois, une opportunité d’apprentissage par le biais des méthodes du retour d’expérience (RETEX) intégré et pluridisciplinaire sur des territoires particulièrement vulnérables, et aussi une occasion rare d’appliquer ou d’inventer des méthodes de transfert de ces apprentissages vers les populations et les autres acteurs de la prévention, de la gestion de crise et de la reconstruction territoriale.
Cette émission valorise l’ANR TIREX qui a mobilisé une partie de l’équipe du LAGAM pendant 4 ans sur les îles du Nord des Antilles (Saint-Martin et Saint-Barthélemy).
Les actions de prévention et de solidarités de Saint-Barthélemy
Depuis Irma, l'île de Saint-Barthélemy est épargnée par les cyclones
Cependant et même si les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont été épargnées par le passage de nouveaux cyclones depuis Irma en 2017, d’autres cyclones se sont abatus sur certaines îles voisines entrainant des actions de solidarités au sein du territoire. Le passages d’autres cyclones au sein de l’archipel antillais ont également permis de mener des actions de prévention.












